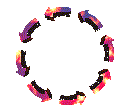|
|
Michel Serres, philosophe :"Le virtuel est la chair même de l'homme" Les nouvelles techniques sont extrêmement anciennes dans leurs buts et extraordinairement nouvelles dans leurs réalisations. Comme l'écriture et l'imprimerie, elles affecteront la plupart des pratiques sociales.
"De nombreux philosophes dénoncent les dangers du développement du virtuel via internet et les techniques numériques. ils stigmatisent la perte de contact avec le réel et l'altération du lien social. comment réagissez-vous à ces critiques ?
- Prenez le cas de Madame Bovary, qui s'ennuie en Normandie pendant que son mari passe son temps à visiter ses clients à la campagne. Elle fait l'amour beaucoup plus souvent en esprit qu'en réalité. Elle est entièrement virtuelle. Madame Bovary, c'est le roman du virtuel. Et quand je lis Madame Bovary, comme n'importe quel autre livre, je suis aussi dans le virtuel. Alors que ce mot semble créé par les nouvelles technologies, il est né avec Aristote. Le modernisme du terme n'est qu'apparent.
"Tous les mots latins en "or" ont donné des mots français en "eur": horreur, honneur... Sauf un ! Lequel ? Le mot amour. Amor a donné amour. Pourquoi ? Il semble qu'il ait été inventé par les troubadours de langue d'oc à l'occasion du départ pour les croisades. Il s'agissait alors de chanter les princesses lointaines. Ainsi, c'est comme si l'amour avait été inventé pour et par le virtuel. "L'absence est à l'amour ce qu'au feu est le vent, il éteint le petit, il allume le grand", écrivait Bussy-Rabutin. Nous sommes des bêtes à virtuel depuis que nous sommes des hommes. Pendant que je parle, une partie de mes pensées est à ce que je dois faire ensuite, une partie est à mes cours de Stanford, une autre se souvient de mon dernier voyage en Afrique du Sud... Toutes nos technologies sont le plus souvent du virtuel.
- Quelles caractéristiques distinguent le "nouveau" virtuel de ce virtuel traditionnel ?
- Quasi aucune ! On va dire que les jeunes sont tout le temps dans le virtuel et qu'ils vont s'étioler... Or, dans notre génération, tout le monde a été amoureux de vedettes de cinéma que l'on n'a jamais embrassées qu'en images. Le virtuel est la chair même de l'homme. Une vache, elle, n'est pas dans le virtuel. Elle est dans son carré d'herbe en train de brouter...
"En revanche, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, chaque fois qu'un géomètre traçait un cercle ou un triangle sur le sol, il ajoutait : "Attention, cette figure n'est pas là, il ne s'agit pas de celle-là, ce n'est pas la bonne !" Où est la bonne ? On ne sait pas. On avait même créé alors un ciel des idées. C'était entièrement virtuel. Le monde des mathématiques est réel, mais il est réel avec un statut bien déterminé, un statut d'absence.
- Tout cela ne vous semble donc absolument pas nouveau...
- En fait, on peut distinguer les arguments "contre" extrêmement classiques, dont on ne s'aperçoit pas à quel point ils sont vieux et se répètent, et de très rares arguments qui, en effet, sont spécifiquement modernes. Parmi les critiques les plus ressassées, on trouve par exemple la quantité d'information que nous ne pourrons pas digérer tellement elle est énorme. Il y a une citation de Leibnitz que je donne souvent : "Cette horrible quantité de livres imprimés qui m'arrive tous les jours sur ma table va sûrement ramener la barbarie et non pas la culture." Leibnitz avait dit cela au XVIIe siècle à propos de l'imprimerie et des bibliothèques. Personne n'a lu toute la Grande Bibliothèque ni celle du Congrès à Washington. Mais le sujet collectif qui s'appelle "nous", l'humanité, l'a lue. Il n'y a pas un seul livre qui n'ait pas été lu par quelqu'un.
"Il faudrait quand même que ceux qui manipulent ces arguments ultraclassiques connaissent un peu d'histoire, un peu d'histoire des sciences et des techniques et un peu de philosophie. Cela les rassurerait tout de suite. Autrement dit, les nouvelles technologies ont deux caractéristiques. Premièrement, elles sont extrêmement anciennes dans leurs buts et leurs performances et extraordinairement nouvelles dans leurs réalisations.
- Nombre d'hommes politiques et d'intellectuels dénoncent les risques de fracture numérique. Qu'en pensez-vous ?
- Prenons l'éducation. On ne compare jamais la fracture que les nouvelles technologies pourraient créer avec celle qui existe sans les nouvelles technologies. Or cette dernière précipite les plus pauvres dans l'ignorance totale. Et elle éduque à grands frais les gens à Standford ou Harvard. Comparée à cette fracture-là, celle que pourrait engendrer le numérique apparaît comme une justice !
"En effet, l'investissement qu'imposent les nouvelles technologies n'est guère supérieur à celui qu'ont consenti les plus pauvres à l'époque où ils ont acheté la télévision. Je ne vois donc pas comment la fracture dite numérique pourrait aggraver la fracture existante aujourd'hui.
"Pour ce qui est du lien social, il est convenu de parler, le plus souvent, de l'impact global des nouvelles technologies en citant la possibilité de communiquer avec des personnes situées n'importe où sur la planète. Mais on oublie toujours que le téléphone mobile, par exemple, a décuplé les contacts de proximité. La plupart des mères de famille ont un portable pour savoir où se trouve leur fille à la sortie de l'école... Cela multiplie les contacts au plus proche. Combien cela coûte-t-il ? Rien d'extraordinaire alors qu'avec les anciennes techniques les coûts sont extraordinaires !
"En matière de fracture culturelle, la même comparaison s'impose. Là encore, la fracture existe surtout avec les systèmes les plus anciens. La télévision a plus apporté aux moins cultivés qu'aux plus cultivés. Ce sont d'ailleurs les gens hypercultivés qui la critiquent. De même, le téléphone de troisième génération va mettre des spectacles et de la culture à la portée de tout le monde. C'est toujours une affaire de coût. Et celui qu'imposent les nouvelles techniques est dérisoire par rapport à celui des anciennes.
- Que vont-elles changer ?
- La société, en grande partie. Comme avec chaque nouvelle technologie. Quand l'écriture apparaît, c'est un lieu commun de tous les historiens que de dire qu'elle a affecté la ville, l'Etat, le droit et probablement le commerce. Une grande partie des pratiques sociales dont nous sommes les héritiers sont issues de l'écriture. Sans parler du monothéisme, la religion de l'écrit. Et puis, quand arrivent la Renaissance et l'invention de l'imprimerie, à peu près les mêmes zones de la société sont touchées : nouvelles formes de démocratie, nouveaux droits, nouvelle pédagogie. C'est ce genre de pratiques sociales dont on peut penser qu'elles seront bouleversées. Et d'ailleurs, elles le sont déjà.
- Quels domaines sont touchés dès aujourd'hui ?
- D'abord toute la science. Depuis l'ordinateur, il n'y a pas une science qui n'ait été touchée de façon profonde, jusqu'à la technique expérimentale ou le recueil des données... Ce ne sont pas les savoirs qui sont transformés, c'est le sujet des savoirs. Nous avons déjà parlé du sujet collectif. Par exemple, les laboratoires travaillent par courriel et en temps réel. Ils n'attendent plus les colloques, les rencontres, les voyages.
- Ces facilités d'échange jouent-elles un rôle dans la création de ce nouvel humanisme auquel vous faites souvent référence ?
- Il s'agit d'un projet qui m'est cher et que j'ai exposé sans succès devant les ministres. Il consiste à dire, contrairement à ce que pensent les pessimistes, que l'ensemble des sciences a dégagé aujourd'hui ce que j'appelle un grand récit. Chaque science ajoute son affluent à cet énorme récit qui se développe un peu comme un fleuve. Ce dernier existait, bien sûr, auparavant mais il était extrêmement fragmenté, moins unitaire, et il n'y avait pas cette espèce de conscience de tous les savoirs d'appartenir à ce récit, d'y apporter sa pierre, de le rectifier sans cesse, de le déconstruire et de le reconstruire. Cet immense récit, qui est aujourd'hui globalement vrai, appartient désormais à la totalité de l'humanité. Il existe, nous avons les outils nécessaires pour nous le transmettre et il constitue aujourd'hui le fondement de notre culture.
- Quels autres avantages voyez-vous à ce temps réel souvent critiqué ?
- La souplesse apportée par le temps réel devient telle qu'il m'arrive, comme à beaucoup de mes amis, d'être déjà scandalisé par les processus anciens qui me paraissent dinosaures. Comme quand il faut se déplacer pour aller à un guichet. On en est encore là !
"Ceux qui critiquent doivent s'apercevoir loyalement à quel point ils sont des dinosaures. Lorsque des jeunes de 16 ou 17 ans équipés de téléphones portables ou de courriel ne prévoient pas de se voir le soir, ils peuvent organiser une rencontre au dernier moment grâce à quelques messages. Auparavant, pour organiser la même rencontre, il aurait fallu plusieurs jours, s'écrire, nommer un patron... Ainsi, le temps réel rend dinosaure le temps d'autrefois. Et tout d'un coup, cela va être vrai pour le travail, l'administration, la politique, l'enseignement...
- Pouvez-vous estimer dans quels délais ces transformations seront effectives ?
- Dans les années 1960, au grand scandale des philosophes, j'ai dit qu'Hermès remplacerait Prométhée, c'est-à-dire que la société de communication remplacerait la société de production. J'ai dû attendre longtemps, quinze à vingt ans, pour que cela arrive. A l'époque où j'ai fait mon rapport sur l'enseignement à distance, je ne pensais pas que ces techniques se développeraient si vite.
"On peut toujours dire ce qui arrivera mais jamais quand cela se produira. Si l'on équipe chaque Français d'un téléphone de troisième génération, ce qui n'est pas coûteux par rapport au PNB, chaque Français, y compris les enfants de 11 ans, pourra donner son avis à chaque instant, sur n'importe quel sujet. Cela ne peut pas ne pas changer les choses.
- L'être humain est-il prêt pour ce changement ?
- Je ne sais pas. Mais je sais que l'œil, qui a été formé à l'époque de Lucy, s'est révélé apte au pilotage d'un avion à réaction. Comment un organe, adapté du point de vue darwinien à la marche dans une forêt, peut-il servir ne serait-ce qu'à la conduite d'une voiture avec les images qui défilent ? On est pourtant passé de la marche à cheval ou à pied à la voiture en cinquante ans. Et nous n'utilisons notre cerveau qu'à 20 ou 25 %. Alors réveillons-nous !
"On oublie, par ailleurs, l'une des grandes lois de la technologie qui est ce que j'appelle l'inversion de la science. Qu'est-ce que la science ? La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. Qu'est-ce que la technologie ? C'est ce que le fils enseigne à son papa. Je ne connais pas aujourd'hui d'adulte un peu rassis, un peu réactionnaire et attaché aux traditions qui, lorsqu'il a un enfant, n'ait pas appris grâce à lui à utiliser un magnétoscope. Par conséquent, cela annule le problème de l'assimilation. Comment un enfant de onze ans peut-il enseigner le fonctionnement d'un appareil considéré comme compliqué à un adulte sortant de Polytechnique ? Il faut en tirer les conséquences. C'est que la technologie n'est pas si difficile que cela.
"Ce phénomène s'appelle la néoténie, en termes d'évolution darwinienne. C'est une invention d'un biologiste néerlandais du début du siècle qui disait que l'évolution allait dans le sens d'un rajeunissement de l'embryon. L'homme ne ressemble pas à un chimpanzé plus vieux, mais à un embryon de chimpanzé plus jeune."
Propos recueillis par Michel Alberganti
Un technophile optimiste
Sa voix roule les "r" comme celle d'un conteur du Sud-Ouest. Michel Serres joue avec gourmandise avec cet organe. Né en 1930 à Agen, il conserve intact un caractère passionné qui, sur de nombreux thèmes, le place en marge des sentiers battus du paysage philosophique français. Début 2000, ne l'a-t-on pas vu participer à l'émission "La Marche du siècle" consacrée aux nouveaux comportements sexuels en compagnie de Brigitte Lahaie, ex-actrice de films pornographiques ?
Passionné par l'éducation, Michel Serres est l'auteur d'un rapport sur l'enseignement à distance remis au gouvernement en 1994. La blessure engendrée par l'accueil glacial réservé à ce travail, en particulier par la presse qui l'a jugé utopique, ne s'est pas refermée. Pourtant, la suite des événements, avec l'arrivée d'Internet, devait largement lui donner raison.
Auteur d'une trentaine d'ouvrages, Michel Serres se distingue par un parcours atypique qui l'a conduit de l'Ecole navale à l'Académie française, où il est entré en 1991. Depuis 1982, il passe une partie de l'année à enseigner à l'université américaine Stanford.
Sans, pour autant, adhérer à la culture d'outre-Atlantique, Michel Serres porte un jugement résolument optimiste sur le développement des nouvelles technologies. Historien des sciences et visionnaire, il se distingue de nombre de ses collègues plus conservateurs en inscrivant les bouleversements actuels de la société dans la continuité de l'évolution de l'homme.
M. Al.