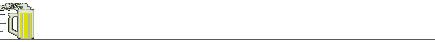La première gorgée de bière
C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir...
Mais la première gorgée ! gorgée ? Ca commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée ! On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit : la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale; le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut: la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur, et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.
On pourrait presque manger dehors
C'est le "presque" qui compte, et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars, la semaine n'a été que pluie, vent et giboulées. Et puis voilà. Depuis ce matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table mise. Mais même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre entrouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte.
« On pourrait presque manger dehors. » La phrase vient toujours au même instant. Juste avant de passe à table, quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Trop tard ? L'avenir sera ce que vous en ferez. La folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors, à passer un coup de chiffon sur la table de jardin, à proposer des pull-overs, à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit, des déplacements contradictoires. Ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud - les chaises sont bien trop mouillées, l'herbe si haute...
Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque... C'est bon, la vie au conditionnel, comme autrefois dans les jeux enfantins : « on aurait dit que tu serais... » Une vie inventée, qui prend à contre-pied les incertitudes. Une vie presque : à portée de la main cette fraîcheur. Une fantaisie modeste, vouée à la dégustation transposée des rites domestiques. Un petit vent de folie sage qui change tout sans rien changer...
Parfois on dit : « On aurait presque pu... » Là, c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé en équilibre sur la boite de Pandore que la notalgie. Mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles, au moment fragile d'une hésitation honnête, sans orienter à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait presque.
Les loukoums chez l'Arabe
Parfois, on vous offre des loukoums dans une boite de bois blanc pyrogravée. C'est le loukoum de retour de voyage ou, plus aseptisé encore, le loukoum-cadeau-du-dernier-moment C'est drôle, mais on a jamais envie de ces loukoums-là. La large feuille transparente glacée qui délimite les étages et empêche de coller semble empêcher aussi de prendre du plaisir avec ce loukoum entre deux doigts - loukoum d'après le café qu'on appréhende sans conviction du bout de l'incisive, en secouant de l'autre main la poudre tombée sur son pull.
Non, le loukoum désirable, c'est le loukoum de la rue. On l'aperçoit dans la vitrine : une pyramide modeste mais qui fait vrai, entre les boites de henné, les patisseries tunisiennes vert amande, rose bonbon, jaune d'or. La boutique est étroite, et pleine à craquer du sol au plafond. On entre là avec une timidité condescendante, un sourire trop courtois pour être honnête, déstabilisé par cet univers où les rôles ne sont pas distribués avec évidence. Ce jeune garçon aux cheveux crépus est-il vendeur, ou copain du fils du patron. Il y a quelques années, on avait toujours droit à un Berbère à petit béret bleu, on se lançait en confiance. Mais maintenant, il faut se risquer à l'eveuglette, au risque de passer pour ce qu'on est ─ un béotien désemparé. On ne saura pas si le jeune homme est vraiment vendeur, mais en tout cas il vend, et cette incertitude prolongée vous met un peu plus mal à l'aise. Six loukoums ? À la rose ? tous à la rose, si vous voulez. devant cette obligeance prodiguée avec une désinvolture que l'on craint légèrement moqueuse, la confusion grandit. Mais déjà le vendeur à rangé vos loukoums à la rose dans un sac en papier. On jette un oeil émerveillé sur la cale au trésor, carénée de pois chiches et de bouteilles de Sidi Brahim, où même le rouge des boites de coca empilées a pris un petit air kabyle. On paie sans triomphalisme, on part comme un voleur, le sachet à la main. Mais là, sur le trottoir, quelques mètres plus loin, on a soudain sa récompense. Le loukoum de l'Arabe est juste à déguster comme ça, sur le trottoir, en douce, dans la fraîcheur du soir ─ tant pis pour la poudre qui s'éparpille sur les manches.
Le dimanche soir
Le dimanche soir ! On ne met pas la table, on ne fait pas un vrai dîné. Chacun va tour à tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croute encore endimanché ─ très bon le poulet froid dans un sandwich à la moutarde, très bon le petit verre de bordeaux bu sur le pouce, pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de six heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un bain. Un vrai bain de dimanche soir, avec beaucoup de mousse bleue, beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque, et les pensées se ramollissent. Surtout ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure chaude. Et puis, quand tout est vide, s'extirper enfin. Prendre un bouquin ? Oui, tout à l'heure. À présent, une émission télévisée fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah ─ regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse ! C'est comme l'eau du bain : une hébétude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufles dans sa tête. et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur peu à peu devient insupportable, et on l'éteint. On se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas comptés, sur fond d'inquiétudes scolaires et d'amours inventés. On se sent traversé. C'est fort comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite, ce petit mal et bien qui revient, familier ─ c'est le dimanche soir. Tous les dimanches soir sont là, dans cette fausse bulle où rien n'est arrêté. Dans l'eau du bain les photos se révèlent.
Appeler d'une cabine téléphonique
Ce n'est d'abord qu'une succession de contraintes matérielles toujours un peu embarrassées : la lourde porte hypocrite dont on ne sait jamais s'il faut la pousser-tirer ou la tirer-pousser: la carte magnétique à retrouver entre les tickets de métro et le permis de conduire ─ contient-elle encore assez d'unités ? Puis, le regard rivé sur le petit écran, obéir aux consignes : décrochez... attendez... Dans l'espace clos, trop étroit et déjà embué, on se tient ramassé, crispé, pas à l'aise. Le pianotage du numéro sur les touches métalliques déclenche des sonorités aigrelettes et froides. On se sent captif, dans le parallélépipède rectangle, moins isolé que prisonnier. En même temps, on sait qu'il y a là un rite initiatique : il faut ces gestes d'obédience au mécanisme raide pour accéder à la chaleur la plus intime, la plus désemparée ─ la voix humaine. D'ailleurs, les sons progressent insensiblement vers ce miracle : à l'écho glacial du pianotage succède une espèce de chanson ombilicale modulée qui vous conduit au point d'attache ─ enfin, les coups d'appel plus graves, en battements de coeur, et leur interruption comme une délivrance.
C'est juste à ce moment là
qu'on relève la tête. Les premiers mots viennent avec une banalité exquise, un faux détachement ─ «oui, c'est moi ─ oui, ça c'est bien passé ─ je suis juste à côté du petit café, tu sais, place Saint-Sulpice.»
Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais ce qu'on entend. C'est fou comme la voix seule peut dire d'une personne qu'on aime ─ de sa tristesse, de sa fatigue, de sa fragilité, de son intensité à vivre, de sa joie. Sans les gestes, c'est la pudeur qui disparaît, la transparence qui s'installe. Au-dessus du bloc téléphonique bêtement gris s'éveille alors une transparence. On voit soudain le trorroir devant soi, et le kiosque à journaux, les gosses qui patinent. Cette façon d'accueillir tout à coup l'au-delà de la vitre est très douce et magique : c'est comme si le paysage naissait avec la voix lointaine. Un sourire vient aux lèvres. La cabine se fait légère, et n'est plus que de verre. La voix si près si loin vous dit que Paris n'est plus un exil, que les pigeons s'envolent sur les bancs, que l'acier a perdu.
L'autoroute la nuit
La voiture est étrange : à la fois comme une petite maison familière et comme un vaisseau sidéral. Å portée de la main, des bonbons menthe-réglisse. Mais sur le tableau de bord, ces pôles phosphorescents vert électrique, bleu froid, orange pâle. On n'a même pas besoin de la radio ─ tout à l'heure, peut-être, à minuit, pour les informations. C'est bon de se laisser gagner par cet espace. Bien sûr, tout semble docile, tout obéit : le levier de vitesses, le volant, un coup d'essuie-glace, une pression légère sur le lève-vitre. Mais en même temps l'habitacle vous mène, impose son pouvoir. Dans ce silence capitonné de solitude, on est un peu comme dans un fauteuil de cinéma : le film défile devant soi, et semble l'essentiel, mais l'imperceptible lévitation du corps donne la sensation d'une dépendance consentie, qui compte aussi.
Dehors, dans le faisceau des phares, entre le rail à droite et les buissons à gauche, c'est la même quiétude. Mais on ouvre la vitre d'un seul coup, et le dehors vient gifler la demi-somnolence : c'est la vitesse crue qui resurgit. Dehors, cent vingt kilomètres à l'heure ont la densité compacte d'une bombe d'acier lancée entre deux rails.
On traverse la nuit. Les panneaux espacés ─ Futuroscope, Poitiers-Nord, Poitiers-Sud, prochaine sortie Marais Poitevin ─ ont des noms bien français qui sentent les leçons de géographie. Mais c'est une saveur abstraite, une réalité aveugle, que l'on efface avec un vieux fond de roublardise cossarde : cette France virtuelle que l'on abolit, un pied sur l'accélérateur, c'est une leçon de plus que l'on apprend pas.
Cafétéria dix kilomètres. On va s'arrêter. Déjà on apperçoit la cathédrale de lumière toute plate au lointain, et de plus en plus large comme le port s'avance à la fin d'un voyage en bateau. Super + 98. Le vent est frais. Cet assentiment mécanique du bec verseur, le ronronnement du compteur. Puis la cafétéria, une épaisseur vaguement poisseuse, comme dans toutes les gares, tous les havres nocturnes. Expresso ─ supplément sucre. C'est l'idée du café qui compte, pas le goût. Chaleur, amertume. Quelques pas gourds, le regard vague, quelques silhouettes croisées, mais pas de mots. Et puis le vaisseau retrouvé, la coque où l'on se moule. Le sommeil est passé. Tant mieux si l'aube reste loin.
Invité par surprise
Vraiment, ce n'était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement, et puis voilà :
─
Tu dînes avec nous ? Mais alors simplement, à la fortune du pot !
Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible; la soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà, en deux secondes, c'est un grand coup de jeune : on peut changer le cours des choses au débotté. Bien sûr on va se laisser faire.
Dans ces cas là, rien de gourmé : on ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Non, la conversation va se mitonner dans la cuisine ─ tiens, si tu veux m'aider à éplucher les pommes de terre ! Un épluche-légumes à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un radis en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités. On accède aux recoins, aux placards. Tu la mets où, ta moutarde ? Il y a des parfums d'échalote et de persil qui semblent venir d'autrefois, d'une convivialité lointaine ─ peut-être celle des soirs où l'on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine ?
Les paroles s'espacent. Plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur, à présent, ce sont ces plages douces, entre les mots. Aucune gêne. On feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « Je crois que tout est prêt » et on refusera l'apéritif ─ bien vrai. Avant de dîner, on s'assoira pour bavarder autour de la table mise, les pieds sur le barreau un peu haut de la chaise paillée. Invité par surprise on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison lové sur les genoux, on se sent adopté. La vie ne bouge plus ─ elle s'est invité par surprise.
Aider à écosser des petits pois
C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliés les bols et les miettes du petit déjeuner, la cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier.
On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé...
─ Je peux t'aider ?
Ca va de soi. On peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes ─ une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amèr, mais frais comme la cuisine de onze heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés ─ tout près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher.
Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la fin d'une phrase; mais l'autre doit garder la tête penchée ─ c'est dans le code. On parle de travail, de projets, de fatigue ─ pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas fait pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contretemps. Il y en aurait pour cinq minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manches retroussées. On passe la main dans les boules écossées qui remplissement le saladier. C'est doux; toutes ces rondeurs contiguês font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis :
─ Il y aura juste le pain à aller chercher.
Le paquet de gâteaux du dimanche matin
Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un paris-brest, deux tartes aux fraises, un mille-feuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné ─ mais quel sera celui-en-supplément-pour-les-gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteaux à la main, plonge avec soumission vers vos désirs; elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton ─ le mille-feuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevés. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile, au destin menacé.
─ Ce sera tout !
Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous, mais dés la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle, et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont à porter comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance, ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule ? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont un goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose ─ autant que çà et là quelques poireaux dépassant d'un cabas.
Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol ─ celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après messe et les bouffées de P.M.U, de café, de tabac. Petits dimanches de famille, petits dimanche d'autrefois, petits dimanches d'aujourd'hui, le temps balance en ostensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème patissière a fait juste une tâche en haut de la religieuse au café.
Le croissant du trottoir
On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien on s'es habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà. On est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose : un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration : on existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulagerie est un peu loin. Kerouac mains dans les poches, on a tout devancé : chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'es du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment.
Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie ─ c'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve aux seuls premiers clients ─ complicité de l'aube.
─ Cinq croissants, une baguette moulée pas trop cuite !
Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique, et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat.
On se retrouve dans la rue. On le sent bien : la marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous le coude, par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant : c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence, et le meilleur est déjà pris.